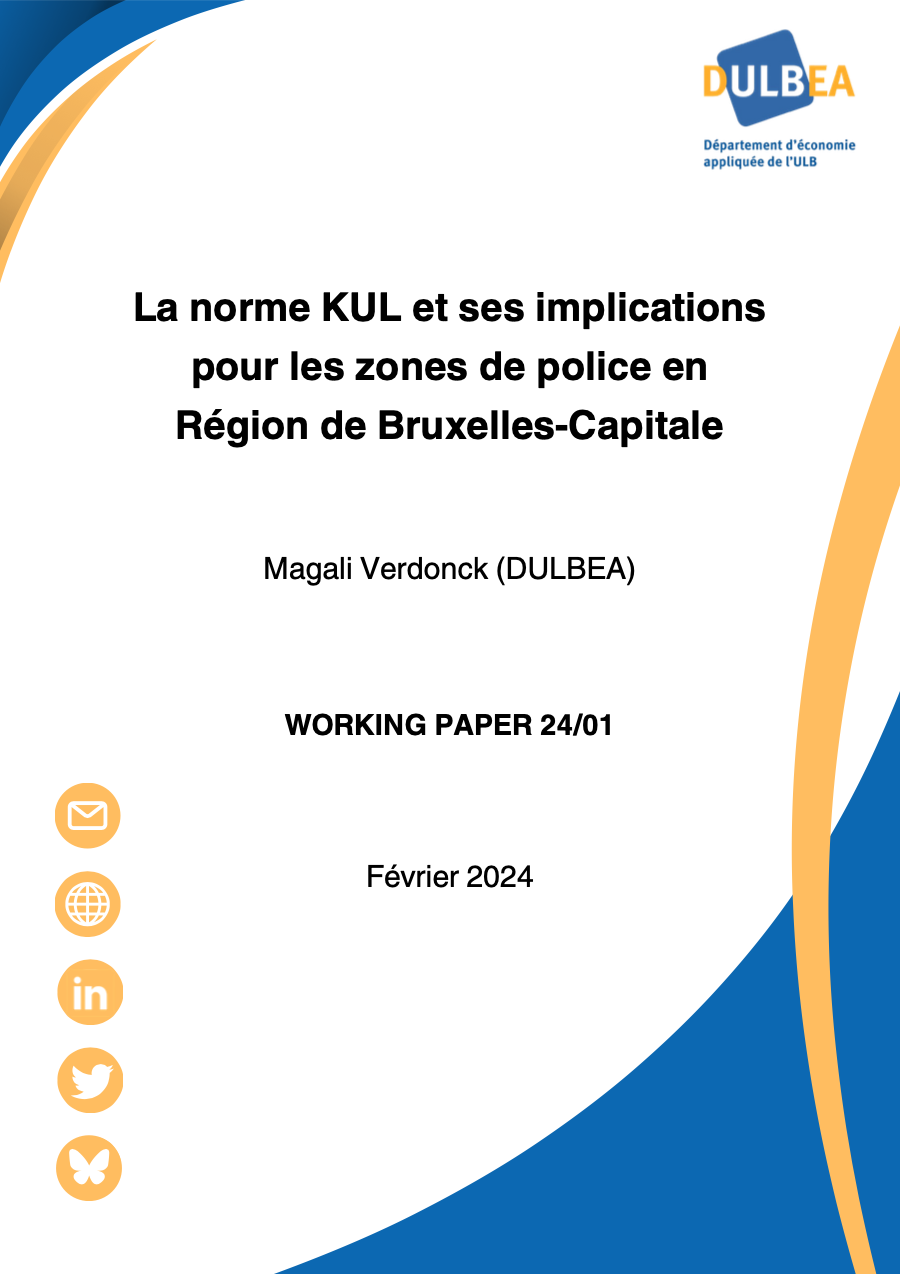Bjørnskov, C. & Jong-A-Pin, R. avec participation de Méon, P.-G.
Edward Elgar Publishing (2025).
Abstract. This definitive Encyclopedia explores the core ideas of public choice theory, including rational choice, voting theory, and political budget cycles. Adopting an interdisciplinary approach, entries cover both empirical, theoretical, and philosophical principles in the field. They explore how political incentives, institutional constraints, and voter behavior interact in contexts ranging from collective action, to democratic backsliding, to fiscal federalism and rent-seeking.
Pierre-Guillaume Méon contributed 3 entries:
« Elections and norms of behaviour » (with Marco Giani)
« Grease the wheels hypothesis »
« Democracy and the quality of institutions »

Aidt, T. S., Lacroix, J., & Méon, P.-G.
American Economic Journal: Economic Policy (2025).
Abstract. We examine how connections shaped transitional justice during France’s post-WWII democratic transition. Parliamentarians who had supported the Vichy regime faced a two-stage purge process involving two courts. Using a difference-in-differences strategy, we find that Law graduates – an influential group with ties to one of the courts – had a 10 to 14 percentage point higher acquittal rate. We analyze 17,589 documents in individual defendants’ files to explain this difference. According to this analysis, indirect connections – connections through third parties – enabled transmission of information to the judges, highlighting how connected elite groups can navigate transitions despite institutional safeguards.
Connections During Democratic Transitions: Insights from the Political Purge in Post-WWII France

De Beir, C., May, X. & Verdonck, M.
Policy Report N°24.02
Rapport uitgevoerd door het Département d’économie appliquée de l’Université libre de Bruxelles (DULBEA) en het InsBtut de GesBon de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire de l’ULB (IGEAT) in opdracht van AcBris
De Beir, C., May, X. & Verdonck, M.
Policy Report N°24.01
Rapport réalisée par le Département d’Économie Appliquée de l’Université libre de Bruxelles (DULBEA) et l’InsAtut de GesAon de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT) pour le compte d’AcAris
Benjamine Dejardin
Policy brief N°25.03
| Dans le cadre d’un séminaire organisé conjointement par le Dulbea et le service Veille, analyse et prospective du Forem, dans la série consacrée aux politiques de l’emploi, Elisabeth Leduc (Erasmus University Rotterdam) a présenté une récente recherche réalisée avec Ilan Tojerow (Dulbea, ULB) fruit d’une collaboration entre le Forem & le Dulbea, portant sur l’impact d’une intervention informationnelle auprès des chercheurs d’emploi. Ce policy brief est une synthèse de ce séminaire. Dans un contexte où le marché du travail est marqué à la fois par des pénuries de main-d’œuvre dans de nombreux métiers et par des difficultés persistantes de réinsertion pour certains chercheurs d’emploi et un faible taux de participation aux formations malgré une offre importante, l’étude en question regarde l’impact d’une information sur les formations menant à des métiers en pénurie. Leduc et Tojerow (2025) ont conduit une expérimentation aléatoire avec le FOREM testant l’effet de l’envoi systématique d’informations sur les métiers en pénurie et les opportunités de formation aux chercheurs d’emploi nouvellement inscrits. L’étude examine si cette communication simple et peu coûteuse peut influencer les choix de formation et, à terme, favoriser une meilleure adéquation entre l’offre et la demande sur le marché du travail. |
Benjamine Dejardin
Policy brief N°25.02
| Dans un séminaire organisé par le Dulbea et le service Veille, analyse et prospective du Forem dans le cadre d’une série de séminaires sur les politiques d’emploi, Arne Uhlendorff a présenté le papier de Cahuc et al. (2024) « Assistance à la recherche d’emploi pour les étudiants en formation professionnelle : Evaluation de l’expérimentation AvenirPro », dont il est co-auteur et qui étudie l’impact d’un programme d’assistance à la recherche d’emploi pour les étudiants en lycée professionnel. Ce policy brief est une synthèse de ce séminaire. Alors que l’insertion professionnelle des jeunes issus de la voie professionnelle demeure un défi important en France, le programme AvenirPro, mis en œuvre par France Travail à partir de 2021, propose un accompagnement à la recherche d’emploi intensif en classe d’élèves de Bac Pro (enseignement secondaire professionnel) puis individualisé après le diplôme. Ce policy brief présente les premiers résultats de la première cohorte d’élèves (2021/2022) de l’accompagnement collectif des étudiants. Les résultats préliminaires montrent un impact significatif et ciblé : six mois après l’obtention du diplôme, les jeunes ayant bénéficié de l’accompagnement en classe affichent une hausse de 45 % de leur taux d’emploi, un effet concentré chez les élèves initialement les plus éloignés de l’emploi. Le programme représente un faible coût par élève (environ 350 €). L’évaluation révèle également une baisse des inscriptions dans l’enseignement supérieur (-22 %) parmi les élèves exposés au programme. Ce dernier effet requiert de plus amples analyses pour être interprétable. |
Sofía Fernández-Guerrico & Ilan Tojerow
Working Paper Nº 25.01
Abstract: We examine the causal impact of high-speed internet on adult mental health using administrative data from Belgium. We exploit predetermined telecommunications infrastructure and broadband technology’s distance-sensitive nature for identification. Our difference-in-differences estimates show internet increased mental health-related disability insurance claims by 0.054 percentage points—a 31% increase relative to the control group. These findings are supported by increased antidepressant use at the municipality level. Results point to a work-related mechanism: effects are concentrated among knowledge workers and those in high work-from-home potential jobs. Time-use data show a substitution from leisure to work and less social interaction on weekends.

Magali Verdonck
Working Paper Nº 24.01
Résumé. L’insatisfaction envers la norme KUL comme clé de financement des zones de police est unanime depuis l’année de son entrée en vigueur, soit depuis 20 ans. En contraste, les initiatives pour la réformer ou la remplacer sont quasiment inexistantes si l’on exclut les diverses rustines et autres bricolages qui ont parfois empiré la situation, en particulier pour les zones urbaines, sans compter la complexité inimaginable qui en a résulté.
Les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale ont plus de raisons encore que les autres de souhaiter une réforme du mode de financement actuel car elles sont particulièrement pénalisées par la prolongation de son utilisation.
Réformer la norme KUL requiert un travail de fourmi, du temps, une période transitoire et sans doute une somme conséquente d’argent (audits, études, montants compensatoires…). Pour augmenter les chances de convaincre que, malgré ces contraintes, il faut se résoudre à aller de l’avant, il est nécessaire d’objectiver les choses. D’une part, en clarifiant le fonctionnement de la norme KUL et ses défauts conceptuels et opérationnels et, d’autre part, en montrant combien les conséquences négatives sont importantes.
Ce rapport répond à cette nécessité, en se focalisant sur les conséquences négatives pour les zones de police bruxelloises et indirectement pour les communes bruxelloises.